Circuit court et agriculture durable : un modèle local face aux défis écologiques et économiques
Comment le circuit court renforce-t-il la résilience alimentaire et soutient-il une agriculture plus durable ? Découvrez les enjeux, les chiffres clés et les exemples du Pays basque, des Landes et du Béarn pour comprendre ce modèle en pleine transformation.
RSEVEILLE ECONOMIQUE
LYDIE GOYENETCHE
6/17/202512 min lire
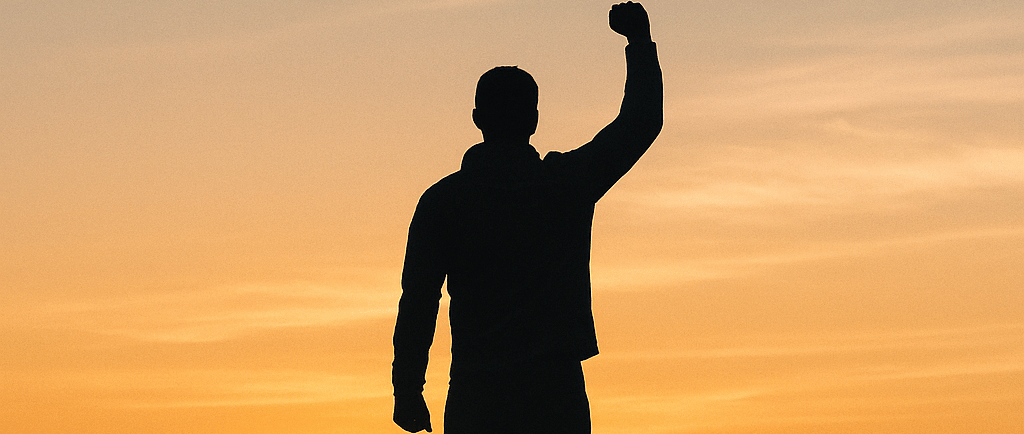
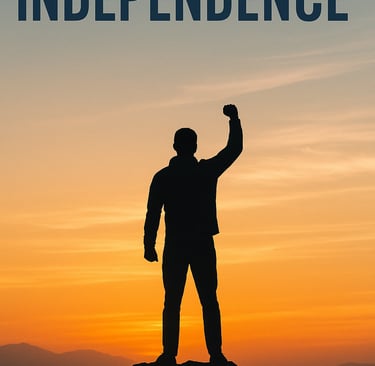
Circuit court et agriculture durable : vers un modèle alimentaire local, résilient et innovant
Cet article fait partie du dossier "inbound marketing pour l'agro-alimentaire et les spiritueux"
Dans un contexte de crise écologique, de flambée des coûts logistiques et de perte de sens dans nos modes de consommation, les circuits courts apparaissent comme une réponse à la fois simple, efficace et profondément durable. En rapprochant le producteur du consommateur, ils réduisent les intermédiaires, les distances parcourues par les aliments, et renforcent les liens sociaux à l’échelle locale. Mais au-delà de leur attrait pour une alimentation plus saine et plus transparente, les circuits courts participent à une agriculture durable : celle qui respecte les écosystèmes, valorise les ressources locales et soutient l’économie de proximité.
Ce modèle de distribution, souvent associé aux marchés paysans, aux AMAP, ou à la vente directe à la ferme, transforme peu à peu nos territoires ruraux. Il encourage les pratiques agroécologiques, préserve la biodiversité cultivée et favorise l’autonomie alimentaire des régions. Dans des zones comme le Pays basque, il s’inscrit dans une dynamique de transition agricole, de résilience face aux chocs, et d’innovation sociale.
Alors que l’agriculture industrielle montre ses limites, peut-on imaginer une montée en puissance des circuits courts comme socle d’un modèle économique viable et équitable ? Quels en sont les leviers, les défis, et les inspirations ?
Du producteur au consommateur un défi à relever ensemble :
Les circuits courts désignent un mode de commercialisation dans lequel un seul intermédiaire au maximum sépare le producteur du consommateur. Aujourd’hui, 23 % des exploitations agricoles françaises utilisent ce mode de vente, avec un taux qui grimpe à 53 % chez les producteurs bio. Les formes sont variées : vente à la ferme (pratiquée par 64 % des exploitants en circuit court), marchés locaux, AMAP, drives fermiers ou magasins de producteurs.
La typologie des produits est également révélatrice : 51 % des apiculteurs, 46 % des maraîchers et 25 % des viticulteurs écoulent leurs produits en circuit court. En région Auvergne-Rhône-Alpes, ce chiffre grimpe à 30 % des exploitants, avec des pics dans certains vignobles de Loire et du Nord Rhône-Alpes où plus de 80 % des viticulteurs vendent en direct. En Corse, ce mode de distribution concerne près de 8 exploitations sur 10.
Du côté des consommateurs, l’adhésion progresse : 66 % des Français consomment en circuit court au moins une fois par mois, et cette part monte à 70 % chez les 55–64 ans. Leurs principales motivations ? Le goût et la qualité (75 %), l’origine locale (57 %) et le soutien à une rémunération juste des producteurs (47 %).
Les circuits courts désignent un mode de commercialisation dans lequel un seul intermédiaire au maximum sépare le producteur du consommateur. En France, 23 % des exploitations agricoles ont recours à ce mode de distribution, un chiffre qui atteint 53 % chez les producteurs bio. Les formes sont variées : vente à la ferme (64 % des exploitants en circuit court y recourent), marchés de plein vent, AMAP, drives fermiers ou magasins de producteurs. Certains produits s’y prêtent particulièrement bien, comme le miel (51 %), les légumes (46 %), ou les fruits (26 %).
Ce modèle, qui séduit 66 % des Français au moins une fois par mois, trouve un écho particulier au Pays basque, territoire de petite agriculture, de cultures diversifiées et d’identité forte. Ici, la structure foncière morcelée, les surfaces disponibles limitées et la forte pression immobilière rendent le foncier difficilement accessible. Pourtant, la demande locale en produits frais, bio ou identitaires ne cesse de croître. Le maraîchage, la polyculture-élevage, les exploitations de moyenne montagne s’y inscrivent dans une logique d’ancrage territorial, de résilience et de reconnexion au consommateur final. La proximité culturelle et la fierté locale renforcent cette dynamique. De Saint-Pée-sur-Nivelle à Mauléon, en passant par Hasparren ou Itxassou, les circuits courts deviennent des leviers stratégiques d’une agriculture paysanne adaptée à la fois aux défis écologiques et à la réalité des vallées basques.
Les circuits courts comme leviers d'une transition agricole localisée, durable et réaliste
À l’heure de l’urgence climatique, de la raréfaction des ressources et de la perte de biodiversité, les circuits courts s’imposent comme un levier central de l’agriculture durable. En réduisant les distances entre le champ et l’assiette, ils participent activement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, tout en limitant les emballages et le gaspillage. Leur impact ne se limite pourtant pas à l’environnement : en favorisant la transparence alimentaire, la traçabilité et une rémunération plus juste des producteurs, ils réconcilient enjeux écologiques, sociaux et économiques. En France, près de 75 % des consommateurs citent le goût et la qualité comme motivations principales pour acheter en circuit court, et plus de 47 % s’y engagent pour soutenir une rémunération équitable des agriculteurs. Ces chiffres témoignent d’un véritable changement culturel dans le rapport à la nourriture.
En Béarn, les circuits courts réactivent les racines d’une polyculture héritée
Sur le territoire du Béarn, où l’élevage et la polyculture traditionnelle ont structuré les paysages agricoles, les circuits courts se développent autour des marchés ruraux, des filières de viande de qualité et de la relance de certaines variétés anciennes. Des fermes situées en zone de coteaux, autrefois tournées vers la production de masse, se réorganisent pour vendre en direct ou en petits collectifs. La diversification devient une stratégie de survie, mais aussi un moyen de tisser un lien renouvelé avec les consommateurs béarnais, de plus en plus attentifs à l’origine de ce qu’ils consomment.
Dans les Landes, une dynamique émergente dans un modèle agricole intensif
Dans les Landes, où domine une agriculture plus industrialisée et extensive, l’essor des circuits courts est plus récent mais gagne du terrain. Certaines initiatives valorisent la transformation locale du maïs, la volaille fermière, ou le maraîchage saisonnier en bordure de littoral, là où la demande touristique rencontre l’offre locale. Le développement reste toutefois freiné par la concentration foncière, l’influence des coopératives et une organisation logistique encore très centralisée. Malgré cela, une nouvelle génération d’agriculteurs cherche à inverser la tendance, portée par une sensibilité écologique croissante.
Au Pays basque, une cohérence culturelle et territoriale forte autour du lien direct
Au Pays basque, la structure agraire morcelée et la forte densité de consommation locale offrent un terreau favorable à l’ancrage des circuits courts. De nombreuses exploitations se positionnent sur une triple logique de qualité, de proximité et de lien culturel. Ici, le lien au terroir, à la langue et à la communauté donne une profondeur identitaire aux circuits courts, qui s’inscrivent dans un mode de vie plus que dans un simple canal de distribution. La part des producteurs engagés dans la vente directe y est nettement supérieure à la moyenne nationale, notamment dans les microbassins de maraîchage, les exploitations en bio et les filières de transformation artisanale. Ce tissu agricole dense, tissé d’initiatives locales, d’engagements coopératifs et de proximité sociale, montre que les circuits courts peuvent incarner un projet global de société, enraciné dans la singularité d’un territoire.
Trois territoires, trois équilibres à inventer
En reliant les enjeux de transition agricole aux réalités concrètes des territoires, les circuits courts montrent qu’il n’existe pas de modèle unique, mais une diversité d’équilibres à construire. Le triptyque Béarn, Landes et Pays basque illustre avec clarté cette pluralité de trajectoires vers une agriculture durable, façonnée à la fois par l’histoire locale, les contraintes de terrain, et la volonté collective de faire lien entre la terre et l’assiette.
Économie territoriale : quels secteurs drainent le PIB ?
Au Béarn, le recul du poids agricole dans le PIB régional s’est accentué, laissant place à l’industrie et aux services. L’agriculture, la sylviculture et la pêche ne représentent désormais que 0,9 % des emplois sur le territoire tandis que l’industrie pèse 17,6 % et le tertiaire 41,4 %, avec 33,9 % dans la santé, l’éducation et les services publics. La chimie‑pétrochimie (à Lacq), l’aéronautique (Safran à Bordes) et l’agroalimentaire (coopérative Euralis, fromagerie des Chaumes, Lindt à Oloron) structurent une économie diversifiée et dynamique, portée par plus de 2 000 emplois dans chacune des filières Sabre.
Dans les Landes, la tradition agricole et forestière a longtemps constitué le socle économique. Aujourd’hui, les circuits courts y émergent mais restent minoritaires face à une agriculture extensive dominée par le maïs, la sylviculture et l’élevage à grande échelle. Le Conseil départemental investit dans des cartes interactives et des labels locaux pour dynamiser les filières de qualité et les produits saisonniers vendus en direct. Les secteurs du tourisme littoral, des services et du commerce complètent le paysage économique, bien qu’ils ne soient pas encore valorisés dans le PIB régional à hauteur de l’industrie ou de l’agriculture traditionnelle.
Au Pays basque, l’agriculture, quoique minorée en comparaison à l’économie régionale espagnole, reste un pilier local : elle représente environ 6 % de l’activité économique locale, contre 3 % en moyenne nationale. La production de maïs, piment d’Espelette, cerise d’Itxassou, productions ovines AOC, pommes à cidre et bio sont des vecteurs de revenus solides. Le maïs confère au département la position de 2ᵉ producteur national, tandis que près de 21 % des exploitations sont dirigées par des agriculteurs de moins de 35 ans, contre 15 % en France. Ces dynamiques démographiques et productives alimentent une agriculture de qualité tournée vers les circuits courts. Parallèlement, la région profite d’un tissu industriel urbain structuré autour du port de Bayonne, de pôles spécialisés (électronique, aéronautique, textile artisanal) et d’un secteur touristique résilient .
Ce panorama territorial montre que, selon les économies, les circuits courts trouvent des contextes contrastés : le Béarn réveille ses traditions agricoles au sein d’une économie industrielle et tertiaire forte ; les Landes tentent de faire émerger des filières locales dans un modèle extensif ; le Pays basque cultive un équilibre entre agriculture identitaire, circuits courts et secteurs industriels diversifiés.
Politiques territoriales et orientation des investissements : quels arbitrages économiques, pour quels travailleurs ?
Les choix opérés par les collectivités territoriales et les préfets de région en matière d’investissement public reflètent, bien souvent, des logiques économiques orientées vers la performance à court terme, la croissance des secteurs à forte valeur ajoutée ou le maintien de l’emploi industriel. Dans ce paysage, l’agriculture durable, bien que reconnue dans les discours, reste rarement considérée comme une priorité budgétaire. Au Pays basque, où l’agriculture représente encore près de 6 % de l’activité locale, les politiques menées par la Communauté d’agglomération Pays Basque ont permis de soutenir certaines filières en valorisant les produits d’appellation, en développant le foncier agricole et en accompagnant l’installation de jeunes exploitants. Mais ces soutiens demeurent fragiles face aux pressions foncières et à la multiplication des projets d’aménagement urbain ou touristique, notamment sur la frange littorale.
Dans les Landes, le contraste est encore plus marqué. L’économie régionale, tournée vers la sylviculture, la grande culture, le tourisme balnéaire et la logistique, mobilise la majorité des ressources et des politiques d’accompagnement. Les exploitants agricoles engagés dans des circuits courts, peu organisés en filières puissantes, peinent à capter l’attention des institutions, sauf lorsqu’ils s’intègrent dans des logiques de valorisation patrimoniale ou touristique. Cette marginalisation relative de l’agriculture durable est également visible dans le manque d’infrastructures logistiques locales pour la distribution en circuit court, ou dans la faible place accordée à l’alimentation locale dans les marchés publics de la restauration collective.
Le Béarn, quant à lui, développe depuis plusieurs années des stratégies de reconversion industrielle et de valorisation des compétences techniques autour de l’aéronautique, des énergies renouvelables et de la chimie verte. Ces orientations ont l’avantage de maintenir un tissu industriel résilient, mais elles absorbent une part importante des aides à l’investissement, souvent au détriment du monde agricole. Les agriculteurs, nombreux à exercer sur des exploitations de taille moyenne, se retrouvent pris entre la nécessité d’innover et l’impossibilité d’accéder à des financements adaptés. Le poids des métropoles voisines, comme Pau ou Tarbes, oriente également les dynamiques territoriales vers les services urbains, l’immobilier et les infrastructures, au détriment du développement rural.
Pour les travailleurs agricoles et les porteurs de projets en circuits courts, ces déséquilibres politiques ont des conséquences concrètes : précarité des revenus, manque de visibilité institutionnelle, accès difficile au foncier, et épuisement physique face à des rythmes de travail soutenus. Si certains territoires comme le Pays basque ont engagé une réflexion structurelle sur la souveraineté alimentaire et la relocalisation de l’économie, la majorité des arbitrages publics reste gouvernée par les indicateurs macroéconomiques classiques, qui privilégient les secteurs les plus contributeurs au PIB régional. Ainsi, l’agriculture durable, pourtant vitale sur le long terme, reste souvent cantonnée à une économie de subsistance, soutenue à la marge par des collectivités qui peinent à en faire un axe stratégique à part entière.
Une souveraineté alimentaire fragilisée : pression économique et dépendance territoriale
Malgré leurs atouts, ni le Béarn, ni les Landes ni le Pays basque ne sont véritablement autonomes sur le plan alimentaire, ce qui pèse lourdement sur les agriculteurs comme sur les foyers. À l’échelle de l’aire urbaine de Bayonne, l’autonomie alimentaire des légumes et fruits dépasse à peine 3 %, et plafonne autour de 1 % pour les céréales, même si la production de maïs atteint un peu plus de 2 % des besoins locaux. Plus globalement, seuls 2 % des 100 principales aires urbaines françaises atteignent une autosuffisance alimentaire supérieure à ce niveau.
Cette dépendance croissante à des filières nationales ou internationales rend les territoires particulièrement vulnérables à l’inflation alimentaire. Alors que l’inflation nationale sur l’alimentation a atteint +12,2 % en 2023 (+21 % sur deux ans), les circuits courts ont mieux résisté, avec une hausse contenue à +6 % entre mars 2022 et mars 2023, contre +12,5 % dans les grandes surfaces . Si ce moindre impact est un atout indéniable, il ne suffit pas à garantir la viabilité financière des exploitations locales, alors que les coûts de production (engrais, énergie, matériel) grimpent quant à eux : en 2023, certains producteurs bio de céréales ont perdu jusqu’à 150 €/tonne, et la réduction des volumes de volailles bio atteint -47 % depuis 2021.
En Béarn, le modèle agricole souffre d’un accès au foncier limité et d’une pression économique encourageant le retour à des cultures intensives. Dans les Landes, l’essor récent du maïs, de la sylviculture et du tourisme nourrit une économie monolithique, mais éloigne le modèle alimentaire d’une autonomie locale. Au Pays basque, malgré une forte valorisation du maïs, du piment d’Espelette, de la cerise d’Itxassou ou du porc basque sous IGP/AOC, la part de ces productions destinée à la consommation locale reste marginale. En effet, ces produits sont largement exportés ou transformés par des filières intermédiaires, plutôt que consommés directement par les populations du territoire.
Cette double contrainte – faible autonomie alimentaire et inflation structurelle – pèse lourdement sur les agriculteurs, confrontés à des marges compressées, et sur les consommateurs, aux premiers rangs de la hausse des prix. Les circuits courts permettent de limiter l’impact inflationniste, mais sans soutien public massif ni politique volontariste à l’échelle territoriale, leur capacité à restaurer une souveraineté alimentaire locale et à amortir les chocs économiques reste trop limitée.
Penser autrement les trajectoires territoriales
Il serait irréaliste de croire que les circuits courts pourraient, à eux seuls, renverser l’architecture économique des territoires. Ils ne remplaceront pas demain les piliers industriels, logistiques ou touristiques qui structurent le PIB régional. Mais ils offrent une autre échelle de pensée, une autre temporalité, et une autre forme de valeur.
En articulant économie vivrière, autonomie locale et solidarité entre producteurs et consommateurs, les circuits courts ne cherchent pas tant à concurrencer les filières dominantes qu’à rouvrir des marges de manœuvre. Pour les territoires en quête de résilience, de cohésion sociale ou de diversification, ils peuvent devenir un complément stratégique, à condition d’être pensés comme tels, et non comme un folklore ou un supplément d’âme. C’est précisément dans cet interstice que peuvent se loger les politiques publiques les plus audacieuses, celles qui articulent les logiques de développement économique avec celles de la transition écologique, sociale et territoriale.
L’exemple de la région de Liège, en Belgique, illustre la force de cette bascule. Dans un contexte similaire de faible autonomie alimentaire et de dépendance aux importations, la région wallonne a lancé, dès 2012, le projet « Ceinture alimentaire liégeoise ». Ce projet a fédéré collectivités locales, coopératives, producteurs, chercheurs et citoyens autour d’un objectif simple : relocaliser 50 % de l’alimentation consommée à Liège en quelques années. En dix ans, la dynamique a permis de structurer plus de vingt filières locales (pain, légumes, fruits, produits laitiers, viande, bière, légumineuses…), de créer des dizaines d’emplois, de relancer des fermes en périphérie urbaine et de favoriser des plateformes logistiques à taille humaine. Ce n’est pas tant la vitesse du changement que sa cohérence systémique qui frappe : tout a été pensé à l’échelle du territoire, dans une logique d’écosystème intégré.
Ce précédent montre que même des territoires contraints, dépendants, ou peu dotés en foncier agricole peuvent transformer en profondeur leur relation à l’alimentation, à condition de construire une stratégie partagée, de longue durée, entre acteurs publics, producteurs et société civile. Le Béarn, les Landes et le Pays basque ne manquent ni d’atouts ni d’initiatives. Ce qui reste à consolider, c’est la capacité collective à faire des circuits courts non plus des marges discrètes ou des utopies rurales, mais une composante centrale d’une nouvelle intelligence territoriale.




EUSKAL CONSEIL
9 rue Iguzki alde
64310 ST PEE SUR NIVELLE
07 82 50 57 66
euskalconseil@gmail.com
Mentions légales: Métiers du Conseil Hiscox HSXIN320063010
Ce site utilise uniquement Plausible Analytics, un outil de mesure d’audience respectueux de la vie privée. Aucune donnée personnelle n’est collectée, aucun cookie n’est utilisé.