"IA, Cognition et Expérience : Pourquoi l’Intelligence Humaine Reste Inimitable ?
L’intelligence artificielle s’impose rapidement en Europe, des services publics aux entreprises, mais peut-elle vraiment remplacer l’intelligence humaine ? Entre machine learning, langage et expérience du réel, découvrez pourquoi les modèles d’IA comme ChatGPT et Perplexity restent fondamentalement limités face à la cognition humaine.
COMMUNICATIONVEILLE SOCIALE
Lydie GOYENETCHE
2/7/20255 min lire
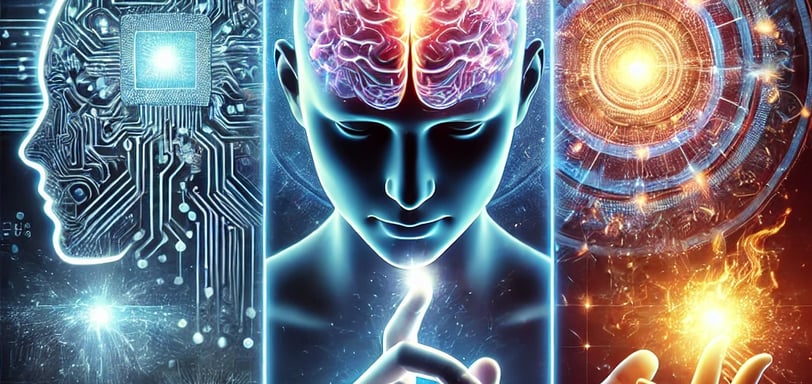
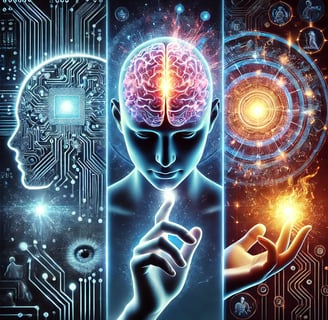
ChatGPT vs Perplexity : Deux moteurs d’IA face à l’intelligence humaine
L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle dans les services publics et les entreprises pose la question de son fonctionnement et de ses limites par rapport à l’intelligence humaine. Deux outils emblématiques de cette évolution sont ChatGPT et Perplexity AI. Bien que leurs finalités diffèrent – le premier étant un modèle conversationnel et le second un moteur de recherche augmenté par l’IA – leur conception repose sur des principes communs de machine learning et d’apprentissage automatique.
Face à ces avancées technologiques, il devient essentiel de s’interroger sur la nature de leur intelligence et de la confronter aux processus cognitifs humains. Loin d’être équivalentes, ces formes d’intelligence obéissent à des logiques radicalement différentes. À travers les théories de Jean Piaget et d’autres psychologues cognitivistes, nous allons mettre en lumière ce qui distingue profondément l’apprentissage artificiel du développement humain.
L’intelligence artificielle et l’intelligence humaine : des fonctionnements opposés
L’IA fonctionne selon des principes de machine learning. ChatGPT et Perplexity AI sont entraînés sur des volumes massifs de données textuelles et utilisent des modèles probabilistiques pour générer ou synthétiser des réponses. ChatGPT, en tant que modèle conversationnel, prédit la suite la plus probable d’une phrase en fonction des milliards de textes sur lesquels il a été entraîné. Perplexity AI, quant à lui, combine un moteur de recherche classique avec un modèle de langage avancé, lui permettant d’aller puiser dans des sources vérifiables et d’en proposer une synthèse structurée.
Toutefois, ces intelligences ne font que traiter des données préexistantes. Elles n’apprennent pas en interagissant avec leur environnement, ne testent pas activement leurs hypothèses et n’adaptent pas spontanément leur compréhension à de nouvelles expériences. Cette caractéristique fondamentale les oppose à l’intelligence humaine qui, selon Piaget, se construit de manière progressive, par essais et erreurs, au fil de l’expérience du réel.
L’apprentissage humain ne se limite pas à l’accumulation de données. Il repose sur un processus actif d’exploration, d’interaction et de transformation des schémas cognitifs. Dès la naissance, l’enfant expérimente le monde par le toucher, l’ouïe et la vue, élaborant progressivement une compréhension de son environnement. À mesure qu’il grandit, il ajuste ses représentations mentales en fonction de nouvelles expériences et de ses interactions avec autrui. Cette plasticité cognitive, qui permet à l’intelligence humaine d’évoluer continuellement, est totalement absente chez l’IA.
Le langage : une construction incarnée dans l’expérience humaine
Un autre élément fondamental distingue l’intelligence humaine de l’intelligence artificielle : la manière dont le langage se développe. Contrairement aux modèles d’IA, qui traitent les mots sous un prisme purement statistique, le langage humain est directement lié à l’expérience du réel et aux interactions sociales.
Selon Lev Vygotski, le langage ne se limite pas à un moyen de communication. Il est un outil de structuration de la pensée, façonné par les échanges avec les autres et par le vécu individuel. Un mot n’est pas seulement un ensemble de lettres ou de sons, il est chargé de sens en fonction de l’histoire de celui qui le prononce. Lorsqu’un enfant apprend un mot comme « feu », il ne se contente pas d’en mémoriser la définition : il en perçoit la chaleur, la lumière, le danger. Son apprentissage est sensoriel, émotionnel et contextuel.
En revanche, une IA ne fait jamais l’expérience du monde. Elle ne perçoit ni la douleur, ni la joie, ni la signification implicite d’une phrase selon le ton ou l’intention de l’interlocuteur. Lorsqu’elle produit un texte, elle ne fait que recombiner des mots en fonction de leurs occurrences les plus probables dans un contexte donné. Cette absence d’expérience vécue limite sa compréhension et la rend incapable d’interpréter pleinement la complexité du langage humain.
Prenons l’exemple du concept de « deuil ». Une IA peut fournir une définition et synthétiser des témoignages, mais elle ne l’a jamais vécu. Elle ne peut saisir la douleur intérieure qui l’accompagne, ni les nuances infinies des sentiments qui varient d’une personne à l’autre. Un être humain, en revanche, comprendra cette notion à travers son propre vécu, ses émotions et ses interactions avec ceux qui l’entourent. Cette dimension incarnée du langage humain est inaccessible aux modèles d’IA, qui restent enfermés dans un traitement purement formel des données textuelles.
Les limites de l’IA face aux situations humaines complexes
Cette différence essentielle entre l’intelligence humaine et l’IA soulève des questions majeures quant à l’utilisation de ces technologies dans des contextes où l’expérience humaine est primordiale. Dans les services publics et les entreprises, l’IA est de plus en plus sollicitée pour automatiser des tâches complexes, notamment dans le recrutement, l’assistance juridique ou même l’accompagnement psychologique.
Or, une IA, même avancée, ne peut réellement évaluer une situation humaine. Dans un conflit professionnel, par exemple, un modèle comme ChatGPT peut analyser des e-mails et détecter des tensions linguistiques. Mais seul un manager humain pourra comprendre les émotions sous-jacentes, interpréter le langage non verbal et ajuster son approche en fonction des réactions des individus concernés. L’IA, en l’absence d’expérience vécue et de subjectivité, ne peut percevoir ni les dynamiques de pouvoir, ni les non-dits, ni les intentions réelles des protagonistes.
Cette limite est particulièrement flagrante dans l’accompagnement des personnes en détresse psychologique. De plus en plus d’outils d’IA sont utilisés pour fournir un soutien émotionnel, mais ils restent fondamentalement déconnectés de la réalité de la souffrance humaine. Une personne endeuillée ou en situation de détresse a besoin d’un échange authentique, où l’interlocuteur partage un espace émotionnel avec elle. Un programme informatique, aussi sophistiqué soit-il, ne peut offrir cette présence humaine essentielle, car il ne ressent ni compassion ni empathie véritables.
Une complémentarité nécessaire, mais une substitution impossible.
Si l’intelligence artificielle offre des outils puissants pour traiter de grandes quantités d’informations et automatiser des tâches précises, elle ne peut en aucun cas se substituer à l’intelligence humaine. Là où l’IA fonctionne sur des modèles probabilistes, l’humain s’appuie sur son expérience, son intuition et sa sensibilité. Là où l’IA manipule des mots sans en saisir la portée vécue, l’humain donne du sens au langage en fonction de son histoire et de son rapport au réel.
L’avenir de l’intelligence artificielle ne réside donc pas dans une volonté de remplacer l’homme, mais plutôt dans une collaboration intelligente où l’IA demeure un outil sous la supervision de l’esprit humain. Son efficacité dépendra de notre capacité à l’utiliser de manière critique et responsable, en gardant toujours à l’esprit ses limites fondamentales.
La véritable intelligence, au-delà des algorithmes et des statistiques, reste celle qui sait faire preuve de discernement, de réflexion et d’humanité.




EUSKAL CONSEIL
9 rue Iguzki alde
64310 ST PEE SUR NIVELLE
07 82 50 57 66
euskalconseil@gmail.com
Mentions légales: Métiers du Conseil Hiscox HSXIN320063010